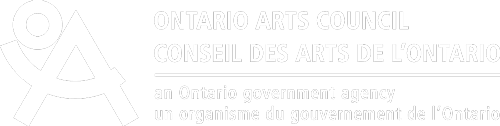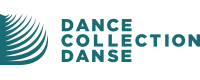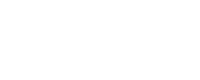MARIE BEAULIEU
FÉV. 2011
HISTORIEN DE LA DANSE
INTRODUCTION
Bienvenue à la page Web de Dance Collection Danse, Historien de la danse du mois. Cette page Web vous présente des entrevues avec un historien canadien de la danse, qui seront publiées tous les deux mois au courant de l’année 2011. À travers ces entrevues, nous espérons vous faire découvrir le métier d’historien de la danse et vous en dévoiler les multiples facettes. De plus, la page Web nous permet de mettre l’historien en avant-scène; celui qui est souvent caché derrière un ordinateur, ou connu seulement par ses textes. Ici, c’est l’historien lui-même que vous aurez l’occasion de connaître.
Ce mois-ci, nous vous présentons Marie Beaulieu, historienne de la danse et professeure au département de danse à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Marie Beaulieu a voué sa vie à la danse: d’abord interprète pour la compagnie Entre-Six et répétitrice pour le Ballet de Montréal Eddy Toussaint, elle a occupé la fonction de directrice des Ballets de l’Opéra de Nice pour finalement compléter son parcours à titre de chercheure et directrice du département de danse à l’UQAM.
En 2008, Beaulieu a complété sa thèse de doctorat sous la direction de Rose-Marie Lèbe, professeure au Département de kinésiologie de l’Université de Montréal. L’approche de son sujet et la structure de sa thèse sont uniques, et sa recherche est vaste et rigoureuse. Il n’est pas surprenant que Beaulieu ait reçu une mention d’honneur pour la qualité exceptionnelle de l’ensemble de sa recherche doctorale.
J’espère que vous aimerez cette première version en français de la page Historien de la danse du mois. Je suis certaine que cette entrevue vous donnera le goût d’en savoir plus sur le travail avant-gardiste de Marie Beaulieu.
Bonne lecture!
Carolyne Clare
DCD Metcalf Foundation Intern
ENTRETIEN

Nom : Marie Beaulieu
Employeur actuel : l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
CC : Quelle est votre formation en danse?
MB : J’ai commencé à étudier la danse à l’Académie de Ballet du Saguenay à l’âge de huit ans. Ma professeure de l’époque, Milenka Niederlova, avait été soliste avec la compagnie des Grands Ballets Canadiens. Par hasard, je l’avais vue danser quand j’avais six ans dans un ballet nommé Sea Gallows. Ce ballet a été une inspiration déterminante dans ma décision de prendre des cours de danse. J’ai étudié avec Niederlova jusqu’à l’âge de quinze ans, suite à quoi j’ai bénéficié d’une bourse d’études à temps plein à l’Académie des Grands Ballets Canadiens à Montréal. Par la suite, ma passion pour la danse ne s’est jamais démentie. Au plus, elle s’est transformée.
CC : Avez-vous travaillé comme danseuse professionnelle?
MB : Oui, à l’âge de dix-sept ans, j’ai été engagée par la compagnie de danse Entre-Six. J’ai dansé avec cette compagnie de 1976 à 1978, et nous avons fait plusieurs tournées et donné plus de 300 représentations. Ensuite, j’ai décidé d’aller étudier à New York. De retour à Montréal en 1986, j’ai travaillé avec le Ballet de Montréal Eddy Toussaint comme répétitrice. Cette fonction et, par la suite, un poste d’assistante chorégraphe m’ont permis d’aller monter des ballets à l’étranger. Dès lors, j’ai pu observer plusieurs compagnies de danse et constater les différences qui existent entre diverses organisations au Canada, aux États-Unis et en Europe. C’est à travers mes expériences professionnelles que j’ai développé un intérêt pour le fonctionnement des compagnies et leur histoire.
CC : Pour quelles raisons avez-vous décidé de commencer des études universitaires en danse?
MB: J’avais 30 ans et je voulais un changement de carrière. Avec les compagnies, je faisais beaucoup de tournées et j’avais envie de stabiliser ma vie. En même temps, je ne doutais pas que je voulais travailler dans le domaine de la danse. J’avais une amie, Iro Tembeck, historienne de la danse, qui m’a suggéré de faire un baccalauréat en danse et de voir où cela me mènerait. J’ai décidé d’essayer.
J’avais déjà un intérêt pour l’histoire. Mon grand-père, qui vivait au nord du Québec, a été un des fondateurs d’une société historique dans sa communauté. De plus, mes cours au CEGEP m’ont initiée aux concepts de l’histoire de la civilisation occidentale. Je connaissais déjà l’histoire de la Grèce et de la Rome antiques parce que j’avais fait du latin et du grec au secondaire. Cette formation a influencé mes réflexions et aiguisé mon intérêt pour l’histoire de la danse.
J’ai décidé d’entreprendre un baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Mon expérience de travail comme professeure de danse m’a bien servie. Dès que j’ai commencé à l’UQAM, j’ai été engagée comme chargée de cours au département. De plus, j’avais enseigné des cours d’interprétation et d’histoire de la danse au Cégep de Drummondville où j’avais pu développer mes qualités d’enseignante, ce qui m’a servie tout le long de ma carrière.
CC : Est-ce que votre expérience professionnelle vous a motivé à faire de la recherche sur les modes de gestion d’une compagnie?
MB : Inspirée par mes expériences de travail professionnel, j’ai commencé à m’interroger sur ce qui permettait la survie de certaines compagnies de danse, tandis que d’autres se voyaient obligées de mettre fin à leurs activités. Ma thèse, intitulée « Panorama d’une compagnie de ballet (Les Grands Ballets Canadiens, 1957-1977): la concrétisation d’une vision », examine la dynamique artistique et le fonctionnement de cette compagnie. Mon sujet se situe entre l’histoire et la pratique de la danse au sein de la compagnie. C’était toujours important pour moi de demeurer entre les deux et d’étudier leurs rapports.
Au Québec, les compagnies de danse qui ont survécu le plus longtemps sont Les Ballets Jazz de Montréal et Les Grands Ballets Canadiens (GBC). Par contre, il y avait aussi d’autres compagnies qui étaient très populaires à une certaine époque mais qui ont dû fermer. Je me demandais pourquoi, surtout que j’avais travaillé avec deux d’entre elles. Ma recherche sur le fonctionnement des GBC m’a permis d’étudier les dynamiques relationnelles d’une compagnie à fond et d’examiner comment ces relations peuvent engendrer et contribuer à la concrétisation d’une certaine vision artistique en plus d’assurer sa survie.
Le développement des GBC peut servir d’exemple de gestion pour les compagnies d’aujourd’hui, car les problèmes auxquels sont confrontés les organismes artistiques n’ont pas beaucoup changé. Les compagnies travaillent encore avec un budget modeste et, souvent, les administrateurs n’ont pas de formation de gestionnaires dans le domaine artistique ou, s’ils en ont une, demeurent aux prises avec des défis liés à la survie. Pour ces raisons, je crois que mes analyses des GBC peuvent être appliquées à des compagnies actives. L’ingéniosité, la créativité et un instinct sûr a permis aux dirigeants des premières années d’accomplir de grandes choses avec peu de moyens.
Par exemple, j’ai découvert que le travail artistique des GBC a mûri quand la compagnie a travaillé avec des chorégraphes originaires du Québec. Face à cette constatation, je crois que d’autres compagnies de ballet pourraient bénéficier d’une collaboration avec des chorégraphes originaires de leur milieu culturel. Ce choix contribue souvent à ce que le public se sente davantage interpellé par les œuvres créées et diffusées. J’explique avec détails les projets qui ont servi aux levées de fonds. Je documente les raisons qui expliquent pourquoi certaines chorégraphies ont bien fonctionné dans certains contextes et à certaines époques et pas à d’autres. J’étais aussi intéressée à savoir comment les individus, leur caractère et leurs compétences, peuvent profondément changer ou modifier l’orientation artistique et administrative d’une compagnie. Les ouvrages de l’expert en gestion, Pierre Bergeron, La gestion dynamique (1995), et des sociologues Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, m’ont donné des modèles à travers lesquels j’ai pu mieux analyser les dynamiques relationnelles des GBC.
Ma question de recherche était à la fois difficile à fouiller et fascinante. Mais j’étais enthousiaste à l’idée de me plonger à fond dans l’analyse d’une compagnie à l’histoire si riche et si complexe. Surtout que, contrairement aux autres deux grandes compagnies canadiennes, aucun ouvrage sérieux n’avait témoigné de son histoire.
CC : Comment avez-vous rencontré Iro Tembeck?
MB: J’ai rencontré Iro Tembeck à l’âge de 13 ans. Je suivais un stage de danse au camp musical de St-Jérôme, et Iro y enseignait la danse moderne. Par la suite, j’ai étudié avec elle le syllabus de l’Imperial Society of Teachers of Dancing alors que j’étais adolescente à Chicoutimi. Par après, j’ai commencé une carrière professionnelle qui m’a amenée à voyager beaucoup. Donc, on s’est perdu de vue pour un temps. À mon retour à Montréal, je l’ai croisée à une soirée bénéfice pour la compagnie d’Eddy Toussaint. Depuis notre dernière rencontre, j’avais grandi et acquis de l’expérience. Iro et moi avions maintenant davantage d’intérêts communs. C’est à cette époque que nous avons développé une grande amitié.
CC : Quelle est l’importance de l’histoire de la danse pour l’art de la danse?
MB : Je crois qu’il est essentiel de savoir d’où l’on vient. Le passé influence nos choix et la manière dont on agit, de même que la façon dont on pratique son art. Si on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas se connaître soi-même. Je ne peux même pas imaginer qu’on puisse ne pas avoir de curiosité pour l’histoire quand on danse ou que l’on veut pratiquer la danse sous une forme ou une autre.
CC : Est-ce que vous utilisez votre corps quand vous faites vos recherches?
MB : Nécessairement, oui. Mon corps me permet d’aborder mes recherches sur l’histoire de la danse d’un autre point de vue. Quand j’étais à New York, j’ai étudié divers genres de danse: le flamenco, la danse africaine, en plus de la « modern dance ». Mon entraînement physique de toutes ces années me permet d’analyser divers aspects de la danse avec une sensibilité au mouvement qui devient davantage de nature ethnographique avec l’âge et l’expérience.
CC : Sur quoi travaillez-vous maintenant?
MB : Présentement, je travaille sur deux projets.
Premièrement, grâce à une subvention de ma Faculté, mon équipe de recherche et moi (Valérie Lessard et Gennaro Di Pasquale) créons un prototype pour sauvegarder les archives des danseurs en créant un DVD qui inclut un documentaire, des menus où des documents variés sont inclus, des témoignages et une biographie détaillée de l’artiste. Nous avons commencé avec le danseur et historien Vincent Warren. Nous avons déjà créé un documentaire de 50 minutes sur Vincent. Vincent est très généreux avec ses archives, et il nous a permis d’inclure des copies digitales de celles-ci. Je crois qu’il est très important de faire ce type de travail et j’aimerais recevoir des subventions dans le futur pour sauvegarder les archives d’autres artistes.
Mon autre projet est celui d’un collectif de chercheurs multidisciplinaires qui vise à documenter comment les journalistes montréalais anglophones et francophones couvraient les disciplines artistiques durant les années 1920 à 1950. Je m’intéresse surtout à retracer quelles rhétoriques étaient utilisées et quelles étaient les polémiques artistiques présentes à cette époque.
CC : Si vous pouviez retourner à une autre époque pour pratiquer ou observer un style de danse, vous retourneriez à quel endroit et à quelle date?
MB : Ce n’est pas facile de répondre! Je retournerais au début du XXe siècle pour observer le travail de Cecchetti, Vaganova et Bournonville. Je crois que nous avons prétendu transmettre leur travail syllabique avec le respect de leur conception de la technique, mais nous leur avons finalement donné une nouvelle orientation et nous avons perdu leurs intentions réelles, ce qui dénature la fonction de ces syllabus et leur intérêt. Je crois que ces danseurs et pédagogues avaient différentes visées biomécaniques et esthétiques que celles que nous leur prêtons aujourd’hui. Il me semble que les photos montrent des corps beaucoup plus harmonieux sur le plan de l’équilibre global des forces que ce que nous en avons fait. Par exemple, je leurs poserais des questions à propos du rapport entre le haut et le bas du corps. J’aurais tellement de questions à leur poser! Il y a tellement de sujets à examiner, il me faudrait 10 autres vies!
CC : On vous le souhaite! Ce serait une bonne chose pour la danse!
MB : Merci.
Publications
- Beaulieu, M. (2009). Relación entre teoría y práctica en el departamento de danza contemporánea de la Universidad de Quebec en Montreal. ARTEA : Investigación y creación escénica. Berlin.
- Beaulieu, M. (2009). Panorama d’une compagnie de ballet (Les Grands Ballets Canadiens 1957-1977), la concrétisation d’une vision. Mouvance, mars 2009. Montréal : Regroupement québécois de la danse.
- Beaulieu, M. (2007). Quel corps pour la danse ? Accents danse, vol. I, #1. Montréal : École supérieure de ballet contemporain (ESBC).
- Beaulieu, M. (2006). Biographie d’Eddy Toussaint. Projet Chorème [en ligne] www.choreme.ca, mars. Montréal : ESBC
- Beaulieu, M. (2006). La danse comme point de rencontre. Le Cahier des routes, année 3, #1 hiver. Montréal : La danse sur les routes.
- Beaulieu, M. (2006). Aller vers ce qui se passe ailleurs. Le Cahier des routes, année 3, #1, hiver. Montréal : La danse sur les routes.
- Beaulieu, M. (2005). Les institutions de formation professionnelles de ballet classique: les gardiens d’une pratique à actualiser. Société des études canadiennes en danse, [en ligne] septembre. Toronto : SECD.
- Beaulieu, M. (2005). Relating theory and practice in the contemporary dance department of the Université du Québec à Montréal. Actes du colloque, DANCE (International Festival of Contemporary Dance of the Munich Arts council). Munich.
PERSONNEL
Miriam Adams, C.M.
Co-founder/Advisor
Amy Bowring
Executive and Curatorial Director
Jay Rankin
Administrative Director
Vickie Fagan
Director of Development and Producer/Hall of Fame
Elisabeth Kelly
Archives and Programming Coordinator
Michael Ripley
Marketing & Sales Coordinator
CONTACT
1303 – 2 Carlton St.
Toronto, ON
M5B 1J3
Canada
Phone: 416-365-3233
Fax: 416-365-3169
info [AT] dcd.ca
HOURS
Mon. – Fri. 10 a.m. – 5 p.m.
Appointment Required
Contact our team by email or call one of the numbers above